Les Colchiques - Guillaume Apollinaire
Aujourd’hui, on va causer d’un poète plongé dans le mal, pour changer...
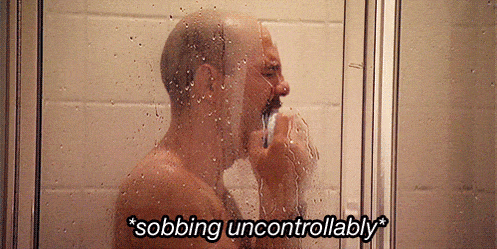
Non non pas Baudelaire. Apollinaire !
Apollinaire amoureux forcément...
Car si Apo le bg, de son vrai nom Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowitzky, a préféré se contenter du 2e nom en partant de la droite, c’est en référence à Apollon, le dieu grec de la beauté et des arts. Le dieu de tous les charmes. Le dieu auquel on ne résiste pas, avec ses abdos et ses yeux de biche.
Cependant, Apo, on lui résiste très bien.
Annie Playden.
Que de souvenirs pour le bel Apo, de galères en élégies, comme tu t’en doutes.

C’est à 22 ans qu’il en fait la connaissance. Il est le précepteur (c’est-à-dire l’enseignant particulier) de la fille d’Élinor Hölterhoff, vicomtesse de Milhau ; elle en est la gouvernante, d’origine anglaise. Entre deux dictées, le poète tombe amoureux, à sa manière, de toute son âme et sa passion, diront certains, de manière maladive et obsessionnelle avancerai-je plus prudemment…
Parce que si ces doux jeunes gens fricotent un peu, suivant leur riche employeur sur les bords du Rhin en 1901-02, la chose paraît claire aux yeux d’Annie : c’est un flirt de grandes vacances, et rien de plus.
Mais pour Apo, ce sera en plus La Chanson du mal-aimé, L’Émigrant de Landor Road, les Colchiques et tant d’autres poèmes encore.
À défaut de caresser sa peau, Apo gratte le papier. C’est comme ça qu’il fonctionne.

Les Colchiques est donc un poème ancré dans une expérience toute personnelle, marquée par une dimension fortement autobiographique.
Mais attention Apo n’est pas du genre à vider son sac et à déballer tout son drama sur la place publique comme le premier influenceur venu. Quand le poète se met à parler de soi, non seulement il n’y paraît pas mais en vérité on ne sait plus vraiment de quoi il parle….
Un pré. Des vaches un peu partout. Des filles filles de leurs filles (?). Puis du poison, du poison et du poison. Okay, Apo rage contre le sexe féminin.
Or l’Apollon des Lettres françaises n’est pas sans maîtriser la culture classique : dans les Colchiques, il évoque le mythe de Médée, sorcière de Colchidie, épouse malheureuse de Jason et accessoirement meurtrière de ses propres enfants ainsi qu’empoisonneuse de la maîtresse de son mari.
Certes quand Apo rage il ne fait pas les choses à moitié. Annie lui dit “non” ; Apo la voit en Médée folle et sanguinolente. Mais est-ce bien étonnant de la part d’un homme qui se voit comme un Apollon ?
Je pose la question ; je n’ai pas la réponse…
On va jeter un oeil au texte ?

Pas encore inscrit sur Archiprof ? 🙈🙈🙈
👇 Par ici les tips et commentaires... 👇
Clique, et crée un compte pour te mettre bien !
Les Colchiques - Guillaume Apollinaire
Le pré est vénéneux mais joli en automne
Les vaches y paissant
Lentement s’empoisonnent
Le colchique couleur de cerne et de lilas
Y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-là
Violâtres comme leur cerne et comme cet automne
Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne
Les enfants de l’école viennent avec fracas
Vêtus de hoquetons et jouant de l’harmonica
Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères
Filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières
Qui battent comme les fleurs battent au vent dément
Le gardien du troupeau chante tout doucement
Tandis que lentes et meuglant les vaches abandonnent
Pour toujours ce grand pré mal fleuri par l’automne

Pas encore inscrit sur Archiprof ? 🙈🙈🙈
👇 Par ici les tips et commentaires... 👇
Clique, et crée un compte pour te mettre bien !
Les Colchiques - Guillaume Apollinaire
I. Lenteur
Le lieu est initialement empreint d’une beauté douce où perce pourtant les symptômes d’une langueur morbide.
1. Lieu ambigüe
Dès l’abord, le pré apparaît comme un lieu éminemment ambiguë où la quiétude se révèle vénéneuse.
Le pré est vénéneux // mais joli en automne (12)
D’ABORD :
- Description du pré, cadre traditionnel bucolique
= genre poétique latin, dans un cadre naturel bienheureux et propice aux sentiments amoureux
+ choix d’un vers classique, l’alexandrin, avec césures régulières ( à 6 temps )
MAIS :
- ambiguïté manifeste, comme une menace sourde…
→ nuance antithétique entre le péjoratif “ vénéneux ” et le mélioratif “ joli ” renforcé par la conjonction d’opposition “ mais ”
OR : déséquilibre de cette opposition
En terme de sons : enlisement dans le négatif mais légèreté du positif
-1 : assonance en [é] dans le 1er hémistiche + hiatus (= succession de deux voyelles, ici “ pré est ”)
→ diction pénible donc ralentie, comme hoquetante
-2 : variété des voyelles apportant une fluidité dans la diction (même s’il y a un 2e hiatus “ joli en ”)
→ impression agréable et énergique
En terme de sens : domination de l’élément négatif sur l’élément positif
-1 : trivialité (caractère ordinaire) de l’adj “ joli ”
-2 : idée de mort connotée par le mot “ vénéneux ”, d’où une force dramatique
+ “ joli ” complété par la saison “ automne ” : thème récurrent du recueil, symbole de mélancolie, comme une anticipation de l’hiver, de la mort et de la solitude
→ l’élément positif comme noyé et absorbé dans un ensemble mélancolique
Les vaches y paissant (6)
Lentement s'empoisonnent (6)
AINSI :
- Progression du poison renforçant les oppositions et divisions…
-1 : radicalisation de l’antithèse : v2 idée positive de nutrition de “ paissant ”
/ v3 idée négative d’empoisonnement de “ s’empoisonnent ”
-2 : participe présent “ paissant ” (action en cours dont la fin est indéfinie)
→ temps ancré dans le moment présent, comme ne devant jamais s’achever
/ adv “ lentement ” complétant le présent “ s’empoisonnent ”
→ idée d’une fatalité inexorable, entraînant imperceptiblement la fin des vaches intoxiquées.
-3 : dislocation de l’alexandrin en 2 hexasyllabes (6 temps x 2 = 12, donc alexandrin)
→ symétrie nette accentuant l’ambivalence du lieu (paître = mourir)
+ perte de l’ordre versifié traditionnel renforçant l’idée de désordre propre à l’ambiguïté
DE PLUS :
- opposition nette doublée d’une contamination sonore progressive :
→ assonance et allitération, comme une imprégnation entre le v2 et le v3 avec occlusives (p et m), nasales (an, en, on) et sifflantes (s)
// mimétique du poison qui se diffuse progressivement
2. Analogies
Au coeur du lieu, fleurit le colchique, qui se fait l’emblème du féminin suivant une relecture de la tradition poétique.
Le colchique couleur // de cerne et de lilas (12)
Y fleurit tes yeux sont // comme cette fleur-là (12)
SOUDAIN :
- Double apparition bouleversant le poème !
-1 : introduction de la fleur motif du titre “ Le colchique ”
-2 : apparition de la femme avec possessif “ tes ”
→ topos (lieu commun) de la poésie traditionnelle amoureuse : association entre femme et fleur
Le colchique couleur // de cerne et de lilas (12)
Y fleurit tes yeux sont // comme cette fleur-là (12)
Violâtres comme leur cerne et comme cet automne (13)
D’OÙ :
- explosion lyrique = démultiplication des analogies en cascade :
-1 : v.4 : comparaison par l’entremise de la “ couleur ”
-2 : v.5 et 6 : répétition du mot de comparaison “ comme ”
+ croisement et redondance entre les éléments comparés :
a) “ tes yeux ” → “ cette fleur-là ” = la colchique
b) “ violâtres ” → “ leur cerne ” avec marques plurielles renvoyant aux “ yeux ”?
c) “ violâtres ” des “ yeux ” → “ cet automne ”
EN FAIT : idée d’imprégnation progressive là encore, de la couleur aux yeux puis au visage et enfin à la Nature entière, avec la saison “ automne ” qui ramène à la fleur
OR :
- Morbidité de cette contamination :
-1 : suffixe péjoratif -âtre évoquant le teint maladif de cette couleur
-2 : mention des “ cernes ”, à la couleur prononcé, symptôme de fatigue et de maladie
-3 : perte de régularité des vers, comme un amolissement grandissant dû à l’irruption de la fleur et de la femme, tous deux toxiques :
→ rejet du verbe “ y fleurit ” comme un délai de retard
+ absence de ponctuation
→ confusion syntaxique possible faisant de “ tes yeux ” le sujet de “ fleurit ” pour renforcer le lien femme-fleur
→ v. 6 : irrégularité avec 13 temps = rythme traînant comme agonisant…
CAR :
- Ici, le colchique = rupture avec le topos poétique traditionnel de la femme-rose :
→ lien avec la mythologie grecque : Médée, fille du roi de Colchide, sorcière empoisonneuse, engendre le colchique en faisant tomber une goutte de poison
→ en anglais, = naked lady renvoyant à l’érotisme du féminin
→ en allemand, = herbstzeitlos signifiant littéralement “ automne éternel ”
DONC : traits caractéristiques du féminin chez Apollinaire -le maléfice, l’érotisme, la mélancolie symbolisée par la saison d’automne !
Le colchique dénote ainsi l’idée d’une féminité inquiétante et troublante, conformément aux habitudes du poète.
3. “Je” lyrique
L’apparition de la femme-fleur est alors l’occasion pour le poète d’exprimer sa désespérante passion.
Et ma vie pour tes yeux // lentement s'empoisonne (12)
ALORS :
- Irruption du “ je ” lyrique au travers du possessif “ ma ” :
→ disproportion entre “ ma vie ” (totalité de la personne) et “ tes yeux ” (élément simple + distance du regard) : image d’une passion forte mais unilatérale ?
+ métonymie de l’être-aimé dans le rapport fétichiste aux seuls “ yeux ” : thème du blason dans la tradition (poème célébrant une partie corporelle de la bien-aimée)
PARALLÈLEMENT :
- opposition du 1er hémistiche -déclaration amoureuse- et 2ème -idée de mort !
a) régularité parfaite de l’alexandrin avec 4 x 3 temps.
b) reprise du v. 3 tel quel.
→ effet de monotonie comme une langueur morbide qui gagne le poète
+ jeu d’allitérations (occlusives et sifflantes) + rallongement des mots
→ même impression d’imprégnation, de contamination imperceptible et lente…
À NOTER :
- Apparition unique du “ je ” lyrique masculin dans tout le poème
+ association entre le v. 3 et 7 créant un lien entre “ vaches ” et amant
→ idée de métamorphose propre à la sorcière transformant ses victimes masculines en animaux (Circé dans l’Odyssée par exemple) ?
S’affirme ainsi l’idée d’une toxicité amoureuse que la suite du poème ne fera que confirmer...
II. Fracas
La déclaration d’amour malheureuse débouche sur une vive agitation, d’abord enfantine et joyeuse mais très vite tempétueuse et angoissante.
1. Enfants
Le tête-à-tête amoureux poétique est rompu par l’énergique intrusion d’enfants bruyants.
Les enfants de l'école viennent avec fracas (13)
MAIS SOUDAIN :
- Irruption inattendue : figure des “ enfants ” avec une énergie joyeuse caractéristique
a) pluriel collectif suggérant une masse sans identification précise
b) verbe de mouvement “ viennent ” renforçant l’idée d’intrusion
c) CCManière “ avec fracas ” soulignant l’impression chaotique
DONC : animation qui rompt totalement avec la monotonie du v. 7, et le poème même !
Les enfants de l'école // viennent avec fracas (13)
Vêtus de hoquetons // et jouant de l'harmonica (14)
Ils cueillent les colchiques // qui sont comme des mères (12)
DE FAIT :
- Un regain d’énergie au fil d’une évocation festive et agitée :
-1 : Sonorités explosives des allitérations en (k), (t) et (d)
+ variété des voyelles dont assonance en (a) et (an)
→ sons éclatants qui contrastent avec les sons étouffés de la strophe précédente
-2 : mention de « l'harmonica » : musique redoublée par le thème du jeu = fête
-3 : irrégularité avec 13 puis 14 temps : ici un désordre suggérant l’agitation des enfants et donc un regain d'énergie qui tire de l'endormissement ?
-4 : action de cueillir les fleurs connotant l’insouciance et la légèreté
ET SI... :
- mention de « l'école » et « hoquetons » (=casaque, sorte de cape pour les écoliers, en grosse toile)
→ voc simple et énonciation ancrée dans le quotidien (sortie des classes?)
- Situation autobiographique ?
1901-02: Apollinaire, précepteur auprès d’une famille en voyage au bord du Rhin
→ il tombe amoureux de la gouvernante des enfants, Annie Playden
OR : 1902 : rédaction des « Colchiques »
→ Annie = la Colchique, d'où la comparaison « qui sont comme des mères », car une gouvernante se comporte comme une mère sans être la mère biologique…
ALORS : après l’aveu du v7 marqué par le “ je ”, interruption d'un tête-à-tête du poète amoureux et de la gouvernante, par les enfants rentrant de l'école ?
Ces enfants semblent constituer donc le trait d'union entre éléments biographiques d'Apollinaire et références classiques au mythe de Médée.
2. Sorcières
D'où l'affirmation du caractère maléfique de la scène, en lien avec la figure féminine de la femme-fleur, alors que la joie bascule dans la tourmente.
Ils cueillent les colchiques // qui sont comme des mères (13)
Filles de leurs filles et // sont couleur de tes paupières (13)
DE LÀ :
- Renvoi au mythe de la sorcière Médée : vengeance après la trahison de son mari Jason
→ empoisonnement de sa rivale et mise à mort de ses propres enfants
-1 : comparaison « comme des mères » : idée d’une maternité faussée, de même que Médée se révéla être une femme folle de jalousie avant d’être une mère aimante
-2 : « filles de leurs filles » : idée tout à fait paradoxale
→ sorte d’ensorcellement renvoyant à l'idée de jeunesse éternelle peut-être ?
→ expression d’un refus radical de la maternité comme Médée meurtrière ?
+ image en tout cas d'un cycle qui revient indéfiniment à son départ
= suspension du temps caractéristique de l'empoisonnement au fil du poème…
Filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières (13)
Qui battent comme les fleurs battent au vent dément (13)
D'OÙ :
- Pressentiment d'un malheur, nettement plus fort que la toxicité de la 1ère strophe…
-1 : passage des « yeux » aux « paupières / qui battent » (= s'ouvrent et se ferment vite)
→ image d'un regard comme troublé (battement de paupières) et donc non-réciproque (marque d’une gêne, d’un refus ?)
-2 : de même surenchère dans l’énergie qui bascule de la joie à la violence :
→ comparaison répétant le verbe « battent » = violence des « paupières »
= violence du « vent » redoublée par le qualificatif « dément » (négation lexicale, = qui n’a pas son esprit)
EN FAIT :
- Idée de battement, d’oscillation qui parcourt le passage :
-1 : battement rythmique = un temps en plus (car on compte 13 temps pour v. 9, 10 et 11) qui oscille, soit dans le premier hémistiche, soit dans le second
-2 : battement métrique = enjambement v.10/v.11, séparant antécédent (« paupière ») et pronom relatif (« qui »)
→ syntaxe de phrase rompue, oscillant entre les 2 vers en question
-3 : battement sémantique (= relatif au sens des mots) = oscillation par le jeu de comparaisons avec renvoi symétrique
couleur des fleurs → couleur des paupières / battement des paupières → battement des fleurs
DONC : va-et-vient vertigineux en un mouvement hypnotique et envoûtant
+ précarité de la relation jamais véritablement stable et assurée.
L'amour semble dès lors compromis, au terme de cette tempête émotionnelle conformément aux amours malheureux du poète.
III. Départ
Aussi le poème, retrouvant une forme régulière traditionnelle, s'achemine-t-il vers son terme alors que sonne l'heure des adieux et du départ…
1. Le chant
Ce dernier tercet s'amorce par la vision du berger chanteur allusive de la figure même du poète, comme si le chant lyrique devait immédiatement succéder à l'amour malheureux.
Le gardien du troupeau // chante tout doucement (12)
MAIS :
- Retour à une figure masculine : « le gardien du troupeau » = rappel à l'ordre
→ protection bénéfique du « gardien » par opposition à l'empoisonnement de la fleur féminine
+ « tout doucement » avec intensif « tout » / « vent dément » du v.11
→ rétablissement de la paix
- thème du chant : figure assimilée à celle du poète et de son chant lyrique
+ lien avec les animaux renvoyant à Orphée, poète mythologie ayant le don de charmer les bêtes par son chant
+ polysémie de « doucement »,
= « lentement » à l'image du poison de la strophe 1
EN EFFET : chant mélancolique comme imprégné du poison et de sa lenteur mais sans la toxicité !
→ le malheur amoureux est comme « digéré » dans la parole poétique.
DE LÀ :
- Retour à un ordre formel : restauration de la forme classique du sonnet amoureux
-1 : tercet final se présentant comme une conclusion pour l'ensemble de l'évocation alors que l'ordre des strophes étaient jusqu'alors bouleversé
-2 : alexandrin régulier avec le respect de la césure, après le tohu-bohu des « enfants » et le « battement » de la bien-aimée
A l'encontre de la violence de la strophe 2, la figure masculine du poète rétablit ainsi l'ordre et met un terme à l'empoisonnement.
2. Adieux
Tandis que lentes et meuglant // les vaches abandonnent (14) Pour toujours ce grand pré // mal fleuri par l'automne (12)
D'où le mouvement de départ des vaches, peut-être symboliques de la passion du poète qui renoncent au pré vénéneux.
D'OÙ :
- Le départ des « vaches », aussi définitif que difficile :
-1 : irréversibilité du départ marqué par le CCTemps « pour toujours »
+ enjambement entre v. 13 et 14 = comme un passage sans retour possible
-2 : idée de lenteur avec le complément « lentes et meuglant » :
+ participe présent (= action qui se prolonge indéfiniment)
+ antéposition avant « les vaches » → un effet de retard, comme si elles trainaient…
ET DONC :
- comme une résistance à l’idée de faire ses adieux au pré…
→ meuglement comme une plainte animale symbolisant cette dimension du regret
- jeu avec la polysémie du verbe accentué par l’enjambement :
a) « abandonnent » isolé au v. 13 = se découragent
b) mais « abandonnent / Pour toujours ce grand pré » = quittent cet endroit
→ mouvement de départ // expression d’un désespoir
// écho de tristesse du poète mal-aimé, confronté à une rupture douloureuse, exprimé sur un mode élégiaque
= genre poétique caractérisé par des émotions tristes relative au temps et au passé, comme le regret, la nostalgie etc.
D’OÙ :
- motif du cycle, très présent chez Apollinaire, marqué par le poids du souvenir :
a) thème de la lenteur = renvoi à la strophe 1, notamment à « lentement » au v. 3 et 7
→ retour à la case départ après l’agitation de la strophe 2 et la rupture
b) v. 14 en écho du v. 1 : qualificatif ambigüe « mal fleuri » alliant la grâce de la floraison au mal de l'empoisonnement // nuance antithétique du v. 1
OR : suppression de l'idée de « joli » liée à la floraison automnale des colchiques
→ désillusion du poète mal-aimé au terme de la rupture…
Ainsi à l'issue du poème, le cycle amoureux est bouclé : n'en reste que le chant poétique célébrant l'ambivalente toxicité des sentiments amoureux…

Tu n'as pas le compte Premium !
Si tu souhaites mettre à jour ton compte, pas de problème !
Clique ici, et mets à jour ton compte (onglet : mon abonnement).
