Zone : l'appel de la modernité ? - Guillaume Apollinaire
Le voici, le poème adoré de Mister BAC ; le poème de toutes les citations pour la dissertation ; le poème qui dit « Modernité poétique ! » à chaque vers.
Prends donc des notes : y a de l'or dans les lignes qui suivent...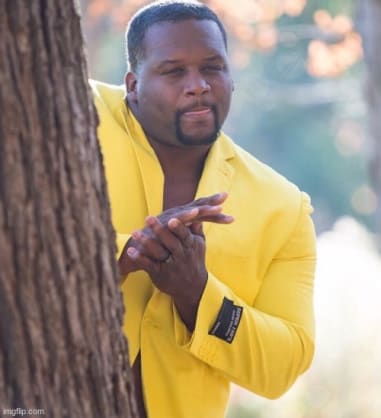
Une chose à savoir : avant d'inventer la modernité sur le papier, les poètes se débrouillent pour la dénicher dans le monde réel -c'est moins compliqué, suffit de se promener...
Et c'est très exactement ce que fait Apollinaire, avec son époque. Car on ne pourrait difficilement faire plus moderne !
La Belle Époque, comme on l'a surnommé après la première guerre mondiale, qui s'étale des années 1880 à 1914, est au coeur d'un boom industriel et technologique sans précédent : la seconde révolution industrielle, autour de l'électricité et de l'industrie chimique, bouleverse la vie courante. Les rythmes s'accélèrent : les transports se mécanisent, ainsi que la presse qui augmentent et démultiplient leurs tirages.
La mondialisation marque aussi un tournant, alors que les empires coloniaux européens connaissent leur plus grand essor.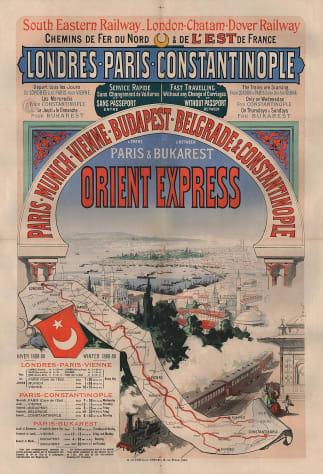
La finance et le commerce suivent de près ce développement tout azimut, faisant émerger de nouvelles pratiques dont la publicité notamment.
Bref, peu importe où l'on tourne la tête : l'époque, la Belle époque donc, crie à chaque coin de rue « modernité ! »
Qu'en est-il du poète, et de la poésie ?
C'est bien le problème pour le coup, celui d'Apollinaire en particulier ; car ailleurs en art, on a pris le relais de ce formidable essor de la civilisation scientifique et industrielle. En peinture comme en musique, l'heure est aux révolutions, aux bouleversements formels qui bousculent les traditions et qui nourrissent tout un tas d'avant-gardes, concentrées au coeur de Paris, alors capitale mondiale des arts !
Cubisme en peinture (bien sûr...) mais aussi prémisses de la musique atonale et de la dysharmonie, avec des compositeurs comme Satie, Stravinsky etc.
Apollinaire, ce gros jaloux, ne veut pas être en reste...
Alcools doit précisément être ce recueil qui marque le pas, et invente une poésie nouvelle, de quoi tutoyer cet Esprit nouveau que l'auteur diagnostique lors d'une conférence en 1917 ( soit 4 ans après la publication officielle d'Alcools, attention! )
Alcools, comme la Belle Époque, est à cheval sur le XIXème et le XXème siècles, dont il marque la transition mouvementée. Il rassemble des poèmes écrits de 1898 à 1913, jouant d'influences et recherches multiples dont l'aboutissement se dévoile, précisément, au coeur de Zone !
Ça tombe bien...
Puisque premier de la liste, Zone est pourtant le dernier poème rédigé par Apollinaire. C'est là qu'il entend y manifester ses aspirations et ses perspectives d'avenir ; c'est là qu'il met en avant son credo esthétique, c'est à dire ce cri qui est un appel à la modernité !
155 vers libres donc, rompant avec la versification traditionnelle, et suppression de la ponctuation à la dernière minute, rompant même avec nos habitudes de lecture et l'usage grammatical.
The beast is released !
En plein coeur de Paris, Apollinaire met en scène son entreprise de création poétique, sa quête de nouveauté, au travers d'une banale ballade en cette ville, au fil d'un quotidien transfiguré par les innovations en tout genre !
Mais alors en quoi ce poème marque-t-il un élan vers la modernité typique d’Alcools ?

Pas encore inscrit sur Archiprof ? 🙈🙈🙈
👇 Par ici les tips et commentaires... 👇
Clique, et crée un compte pour te mettre bien !
Zone : l'appel de la modernité ? - Guillaume Apollinaire
À la fin tu es las de ce monde ancien
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin
Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine
Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes
La religion seule est restée toute neuve la religion
Est restée simple comme les hangars de Port-Aviation
Seul en Europe tu n'es pas antique ô Christianisme
L'Européen le plus moderne c'est vous Pape Pie X
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient
D'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières
Portraits des grands hommes et mille titres divers
J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom
Neuve et propre du soleil elle était le clairon
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent
Le matin par trois fois la sirène y gémit
Une cloche rageuse y aboie vers midi
Les inscriptions des enseignes et des murailles
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent
J'aime la grâce de cette rue industrielle
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes

Pas encore inscrit sur Archiprof ? 🙈🙈🙈
👇 Par ici les tips et commentaires... 👇
Clique, et crée un compte pour te mettre bien !
Zone : l'appel de la modernité ? - Guillaume Apollinaire
Cri
Cri = titre initial du poème, =idée d’une réaction de rejet violente, un « coup de gueule » en somme.
1. Contre-temps
Désigné comme art poétique, Zone s’ouvre sur une interrogation sur la modernité et son temps.
De fait un rapport au temps problématique dès les premiers mots : “à la fin” inaugurant pourtant le poème et le recueil / idée de commencement avec “ce matin”, CCT du v.2 = Alcools conjugue paradoxalement début et fin : dernier poème écrit (1911) = 1er du recueil + emploi du présent / mention d’une époque révolue (“vivre dans l’antiquité”)
D’où la métaphore filée Tour Eiffel = bergère (jeu de mot aussi avec la berge de la Seine) + “troupeau des ponts”, où les arches = animaux quadrupèdes et les bêlements = bruits du trafic? → assimilation du fleuron industriel le plus moderne (1889) avec la figure pastorale (=genre poétique latin, se déroulant dans un cadre rural idyllique avec des romances entre bergers et bergères) la plus classique + emploi lyrique vieilli du “ô” pour l’apostrophe, presque ironique ici : là encore paradoxe où le tout neuf (//début) = le très vieux (//fin).
Le moderne paraît donc engluée dans le classique, et l’avenir ne renvoyer qu’au passé -> temps dans l’impasse: 3 premiers vers construits selon une symétrie (v.1 : cri de lassitude / v.2 : regard sur la ville, avec ravalement du moderne dans l’ancien /v.3 : cri de lassitude bis) -> monostiche symptomatique de cette impossibilité de progression, comme si l’élan poétique calait… + panorama depuis une rive ou un pont (enfilade des ponts à l’horizon) mais manque le fleuve (=passage du temps, chez Apollinaire, cf. Le Pont Mirabeau).
Le poème s’amorce sur l’anomalie d’une modernité empêtrée dans la tradition, d’un avenir orienté paradoxalement vers le passé…
2. Ras-le-bol!
Voilà pourquoi, à ce constat paradoxal répond le refus du poète en quête d’un renouveau, à même de purifier la modernité du passé dans lequel elle demeure engluée.
Si le monostiche trahit un élan poétique entravé, cette immobilisation lyrique est douloureuse : thème de la fatigue et du dégoût + v.1 qui se mue en alexandrin à condition d’effectuer une diérèse “an-ci-en” (=”mal délicieux” dans Le Pont Mirabeau, effet désagréable exprimant une douleur latente) -> se plier à l’ordre traditionnel = dissonance sonore qui irrite l’oreille.
Plus encore, cet échec de l’élan lyrique = emploi du pronom “tu” (=poète qui parle de soi comme d’un autre) : sentiment d’aliénation (perte d’identité dans ce qui est étranger à soi) dans la tradition, le passé // sentiment de déphasage comme s’il ne parvenait pas à être présent à lui-même, pour dire “je”, en raison du temps de retard que creuse la tradition ; donc double défaite du lyrisme, dans la perte de l’élan émotionnel (discontinuité des vers) et du “je” lyrique (décalage du pronom “tu”).
Révolte qui transparaît dans le rejet du classicisme : abaissement du niveau de langue entre v.1 et v.3 (noblesse de “tu es las”/trivialité de “tu en as assez”) ; plus encore fuite dans le vers libre (v.2 = 16, v.3 = 22!) comme une fugue où l’on se perd (accentué par l’absence de ponctuation), avec des vers qui trouvent difficilement leurs fins en quelque sorte.
Ainsi cet échec de l’élan lyrique pousse le poète à chercher des forces nouvelles pour arracher la modernité présente à l’empreinte passée de la tradition.
L’éternel et le transitoire
2 notions en référence à la définition baudelairienne de la modernité :
“La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable.” Le peintre de la vie moderne, Baudelaire.
1. Prendre de la hauteur
Ce temps chamboulé où modernité et ancienneté se confondent nécessite de remettre les pendules à l’heure.
Pour résoudre le pb d’une modernité aux allures de passé, recherche d’un mouvement d’élévation : opposition des “automobiles”, en plein boom industriel à l’époque mais = “anciennes” car déplacement à l’horizontale / lien de comparaison entre “la religion” et l’aviation (“hangars de Port-aviation”) → ressemblance concrète des églises et des “hangars”, espace au vide impressionnant + idée commune d’élévation, spirituelle ou physique.
Idée paradoxale : aviation = rupture majeure créant un mode de locomotion inédit (/“automobiles”, simple modernisation mécanique de la locomotion terrestre déjà existante) mais ici louange de “la religion” fondée sur l’idée d’immobilité (répétition de “est restée”)...
Une élévation verticale qui serait à la fois rupture et immobilité ? mouvement horizontal = linéarité du temps, où le passé touche à l’avenir / mouvement vertical = arrachement au passé, et au flux linéaire du temps → l’éternité au centre de la foi religieuse (Dieu = l’Eternel), d’où l’amorce d’un élan poétique porté par l’espoir d’une modernité détaché de tout passé : après les monostiches, tercet étroitement prolongé par le contre-rejet des v.6 et v.7
Ce désir d’arrachement, au passé et à la lassitude, trouve d’abord son mouvement d’élévation dans l’éternité religieuse.
2. L’interpellation religieuse
D’où l’amorce d’un dialogue intime avec la religion et ses figures sacrées…
Apostrophe lyrique et emphatique “ô Christianisme” et “Pape Pie X” (// v.2) + tutoiement et vouvoiement → communication réelle : enthousiasme marqué par la redondance des louanges, avec antithèse négation de “antique” / affirmation de “moderne” + tournures hyperboliques avec “seul” et la forme superlative “le plus moderne” + ton direct du présentatif “c’est”.
Mais // v.2, un tour grotesque, ici idée aberrante : Pie X incarne dans l’histoire de la papauté un regain de conservatisme (Encyclique Pascendi en 1907 condamnant toute forme de “modernisme”, = hérésies du point de vue de la doctrine... ) → pied-de-nez à l’actualité : d’où peut-être le vouvoiement, + distant que le tutoiement, = respect de la sainteté papale mais aussi recul vis-à-vis de cet élan vers la religion?
D’où le retour au “tu” faussé (le “je” non-présent à soi) introduit par “Et toi” avec rupture de la coordination + pronom tonique (=insistant) → échec de la religion : enjambement v.9/v.10 marquant l’hésitation.
Car sentiment de “honte”: personnification métonymique du v.9 → impression qu’il est “mal vu” d’être croyant en 1913… / désir de “confession” (=rituel de purification pour se débarrasser des péchés passés, et donc du passé qui encombre).
De fait “la religion” avec article défini généralisant → “une église” avec article indéfini d’un lieu parmi d’autres // “christianisme”, principe universel → “Pie X”, individu particulier : l’envol vers l’éternel retombe dans l’enfermement (=mouvement “entrer dans”) d’une tradition!
L’éternité, et son mouvement d’ascension rompant avec tout passé, n’aura pas eu lieu car elle demeure compromise avec une église trop passéiste…
3. Embrasser son temps
Si l’éternité paraît barrée, peut-être l’instant dans son actualité immédiate permettra-t-il de figer le temps mobile afin de rompre avec le passé.
Quête de l’instant présent : simplicité syntaxique, avec des présentatifs (locutions déictiques pour montrer les choses présentes, “voilà” et “il y a”) + accumulations renforcées la suppression de la ponctuation → succession de GN = succession d’instants.
Surtout valorisation de la culture populaire et des médias modernes : “prospectus”, “catalogues”, “affiches” → publicité renvoyant à la consommation de masse et au commerce / ici = “la poésie”, forme littéraire noble et prétendument hors du marché.
Idem avec la “prose” → “journaux” avec romans-feuilletons (genre policier apparaissant vers la fin du XIXème), illustrations à la une (“portraits des grands hommes”) et jeu de mot (“titres divers” = diversité de titres + titres de fait-divers)
Surtout image d’une profusion : omniprésence de pluriels collectifs + dissymétrie entre le prix bas (“25 centimes”) et la richesse des compléments (“grands”, “divers”, “mille” + intensif “pleines de”) + double apposition du v.14, comme une énumération qui n’en finit pas.
En somme vigueur d’un lyrisme moderne : d’où le thème du chant au v. 11 avec syllepse possible du CC de manière “tout haut”, =de manière audible (alors synesthésie du visuel et de l’auditif → transfiguration poétique) mais aussi =en hauteur (“les affiches” accrochées sur les façades de bâtiments) renvoyant à l’élévation de la religion et de l’aviation!
Au fil de cette promenade en ville, guettant une modernité arraché au passé, l’instantanéité des médias industriels ont su insufflé un renouveau lyrique.
Modernité présente
1. Le temps retrouvé
(titre en référence à l’oeuvre de Proust où la quête de soi rejoint la quête d’un temps passé jugé perdu)
Dès lors le poète peut renouer avec une présence au monde à même de nourrir son élan poétique et un lyrisme d’un nouveau genre.
D’où : 1. “tu” du soi déphasé → “je” du poète présent à soi-même.
2. Passé composé “j’ai vu + CC de temps “Ce matin” (déjà au v.2, v.10 et v.12 mais avec du présent de l’indicatif) = dimension du souvenir qui ne renvoie plus au passé et à sa lassitude mais à la modernité et son renouveau.
3. Continuité du texte, emporté par l’enthousiasme, avec la + longue strophe du passage.
En effet le poète peut construire du neuf : qualificatifs “neuve et propre” // virginité du regard (souvenir du “j’ai vu” / oubli du “nom” = perception affranchie de toute connaissance, tout préjugé, toute histoire).
Dès lors transfiguration brusque de l’ordinaire : désignation triviale “une jolie rue” marqué par l’article indéfini → métaphore grandiloquente “clairon du soleil” avec synesthésie (lumière = son) + inversion syntaxique avec antéposition du CDN de “clairon” avant le verbe (style soutenu tout sauf ordinaire…)
Ainsi, inspiré par ce temps de l’instantanéité, le poète trouve la force de transfigurer sa perception de la ville, en l’espèce d’une rue industrielle.
2. L’épaisseur du quotidien
Toutefois cette vision d’un instant se prolonge dans un quotidien marqué par le rythme et l’énergie de la vie moderne.
L’instant de contemplation débouche en effet sur la rencontre des autres (/solitude du “tu” poétique jusqu’alors, y compris dans la honte paradoxale du v.9 avec métonymie) : accumulation (// v.11) avec rythme ternaire réunissant tous les niveaux hiérarchiques + déséquilibre avec rallongement du dernier GN (comme un regard attardé sur la beauté féminine?).
La rencontre des autres = partage d’une rythme de vie → mention des emplois des temps et horaires du v.18 avec CC de temps rejetant le verbe “y passent” au présent de d’habitude à la fin comme si entre temps la rencontre dans l’instant (“ce matin”) → fréquentation dans la durée (généralisation “le matin” au v. 19).
Mais transfiguration de ce quotidien à son tour, ciblant le son : personnifications avec “gémit”, “aboie” et “rageuse” renforçant la syllepse “la sirène” (=alarme, mais aussi figure mythologique plaintive), ancrées dans la rue avec la répétition du pronom “y” se rapportant au lieu.
Nuance avec connotations négatives de souffrance et de violence : animalisation de la cloche ou plainte du gémissement renvoyant à l’énergie folle de la vie industrielle et de son agitation.
L’instant de la vision s’est densifié en un quotidien partagé et en un chant lyrique prolongé où trouve à se maintenir ce rapport revigorant au présent.
3. Art nouveau!
Et cette contemplation joyeuse d’un quotidien mouvementé débouche sur un sens esthétique nouveau privilégiant la dissonance.
D’où le prolongement d’une transfiguration sonore à une visuelle : accumulation d’éléments colorés (d’où la comparaison avec les “perroquets”) à l’image de la prolifération au pluriel des v.11 et v.17 mais renforcé par l’enjambement du v.21 au v.22 → disparate, dysharmonique (//bruit violent de la sirène et de la cloche) = esthétique nouvelle de la dissonance en lien avec la musique atonale (rompant avec le principe harmonique) ou avec le cubisme (cassant l’unicité de la perspective).
De plus registre sensitif qui culmine dans la synesthésie sonore et visuelle du verbe “criaillent” → son désagréable renvoyant à l’idée dysharmonique de la dissonance + personnification prolongeant la comparaison avec les “perroquets” : sursaut de vie dans cette image animale.
D’où l’affirmation d’un lyrisme nouveau et complet : formulation triviale “j’aime la grâce” → “je” lyrique + émotion redoublée par le terme de “grâce” aux connotations théologiques fortes (grâce = condition bienheureuse accordée par Dieu : retour de l'Éternel manqué?).
Mais ancrage dans le présent le plus immédiat, le plus réel : déictique “cette” du v.23 + privilège de la modernité dans le choix de la “rue industrielle” + précision extrême (dénotant avec la concision traditionnelle du vers poétique) dans l’essai de localisation urbaine au v. 24.
Ce cheminement urbain, cumulant questionnement du temps et contemplation de la ville, a donc permis de préciser les principes-clé d’une esthétique moderne en rupture avec la tradition où le lyrisme poétique trouve à s’inscrire plus large d’un art nouveau contemporain, renouvelant tant le paysage de la musique que de la peinture.
Apollinaire s’est efforcé d’être de son temps, et ce faisant il a prêté une voix à son temps.

Tu n'as pas le compte Premium !
Si tu souhaites mettre à jour ton compte, pas de problème !
Clique ici, et mets à jour ton compte (onglet : mon abonnement).
