Le portrait de Mademoiselle de Chartres - Marie Madeleine La Fayette
Le roman au XVIIème siècle c’est pas trop ça. Tu vois, à l’époque, on aimait l’Antiquité, les rois et les reines, et surtout Dieu. Dans le roman, on parle plutôt des sentiments, de la galanterie et de la famille, des petites choses de la vie et du cœur quoi, et pas des saints ou des grandes choses. D’ailleurs, « roman », ça vient de la langue « romane », qu’on parlait dans le Nord de la France au Moyen-Âge, par opposition au latin. Et le latin, déjà à l’époque, c’était super difficile et réservé aux textes sérieux et sacrés. Donc le roman, c’est pas ouf si tu veux faire le BG à la cour. C’est d’ailleurs pour ça que Madame de Lafayette le publie anonymement… Elle assume pas trop.
Pourtant, ce petit roman qu’est la Princesse de Clèves, il a marché du tonnerre ! Madame de Sévigné, la bestha de Madame de Lafayette, a même écrit que c’était une des plus « charmantes choses que j'aie jamais lues ».
Faut dire qu’il est beau ce roman. Déjà, il est classique. Quand on est classique, on privilégie la raison, même si les sentiments mettent le bazar (ah l’amour !), on veut de la beauté et du raffinement, on est galant et « bienséant ». Bref, t’imagine, c’est les soirées tendues chez Monsieur le duc. D’ailleurs, c’est super important d’être bien né, de venir d’une bonne famille aristo, d’avoir de bonnes manières. Au point qu’on en fait tout un plat et que ça devient hyperbolique : tout le monde est vraiment super génial.
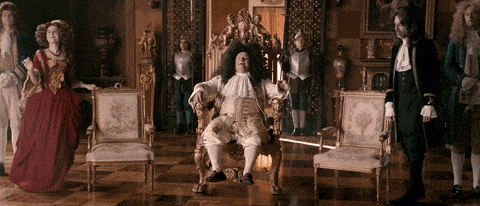
En apparence seulement, parce que par derrière, c’est souvent hypocrisie et infidélités. Donc pour contrebalancer ces pulsions, on brosse des portraits moralisateurs et oppose les passions à la vertu et à la fidélité. Pour la faire simple : la Princesse de Clèves, c’est une bombasse, elle est canon, intelligente, riche et de bonne famille, et en plus c’est pas une fille facile, parce qu’elle a des principes et qu’elle a été bien éduquée ! Et pourtant, elle aussi, elle va tomber amoureuse…

Allez c’est parti, on va voir pourquoi la Princesse c’est la plus belle et la plus pure, et pourquoi elle fait chavirer le cœur des hommes, tout ça en trois parties, comme d’hab’.

Pas encore inscrit sur Archiprof ? 🙈🙈🙈
👇 Par ici les tips et commentaires... 👇
Clique, et crée un compte pour te mettre bien !
Le portrait de Mademoiselle de Chartres - Marie Madeleine La Fayette
Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eût en France ; et quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille ; la voyant dans sa seizième année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle ; il fut surpris de la grande beauté de mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle ; tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charmes.

Pas encore inscrit sur Archiprof ? 🙈🙈🙈
👇 Par ici les tips et commentaires... 👇
Clique, et crée un compte pour te mettre bien !
Le portrait de Mademoiselle de Chartres - Marie Madeleine La Fayette
I. Mademoiselle
Du début à « ...à la lui rendre aimable. »
1. L'apparition
L'héroïne se caractérise par sa formidable beauté.
Mlle de Chartres pas encore une personne mais une pure apparence : tournure impersonnelle du verbe « paraître » + métonymie (la beauté = la personne toute entière) + article indéfini « une » qui rend anonyme.
Mais ici non un défaut de personnalité, au contraire un surcroît d'apparence (cf champ lexical de la vue : « attira les yeux », « voir » → « admiration ») : reprise hyperbolique de « beauté » avec adj mélioratif « parfaite », manifestant l'idéalisation
D'où une opposition : apparition singulière / masse indistincte de la Cour → singulier « une beauté » / pluriel « les regards de tout le monde » + sujet « elle » / « on » indéterminé et pluriel indéfini « de belles personnes ».
Bref, une beauté idéale qu'on ne peut décrire directement, mais qui se lit dans le regard des autres : d'où le raisonnement (« puisque ») où la fascination de la Cour prouve la perfection de Mlle de Chartres (l'intensif « si accoutumé » : elle impressionne là où plus rien ne devrait impressionner).
Cette beauté idéale se perçoit sur le fond de la Cour dont le regard est inévitable.
2. La lignée
De fait, au-delà des apparences, c'est le lignage aristocratique qui pèse à la Cour.
De l'apparition idéale à la consistance du nom propre : conformément aux mœurs aristocrates, affiliation à une lignée noble (notion de « maison » avec la mention du vidame de Chartres).
La beauté idéale rejoint l'excellence sociale, avec le superlatif « une des plus grandes héritières de France » qualifiant l'aisance matérielle + éloge du lien familial au travers de la figure maternelle (rythme ternaire solennel alliant qualités sociales « le bien » et morales « la vertu et le mérite », ponctué par le mélioratif hyperbolique « extraordinaires »)
Echo des valeurs aristocratiques de Cour : culte de l'apparence + dignité sociale et économique de la lignée, propre à la société du XVIème siècle.
Entre apparences et titres de noblesse, l'héroïne manque encore d'une réelle profondeur psychologique.
3. Analepse
Les choix narratifs, quittant l'univers de la Cour, permettent d'approfondir les personnages.
Analepse (retour-en-arrière du récit) explicative quittant le contexte de la Cour, donc des apparences et des titres, et ouvrant une dimension psychologique plus riche : thème du deuil et de la vertu + dévouement à l'éducation de sa fille (champ lexical de l'effort, travail et calcul : « donné ses soins », « travailla », « cultiver », « songea » + tournure corrélative pour surenchérir « pas seulement... aussi... »).
Instruction morale préfigurant dilemme moteur de l'intrigue (d'où le redoublement « donner de la vertu » et « la lui rendre aimable », associant Amour et Vertu quand la suite du roman ne fait qu'opposer les 2 choses).
Ce retour en arrière permet d'ancrer le récit dans un questionnement touchant à la morale.
II. Leçons
De « La plupart des mères... » à « ...d'aimer son mari et d'en être aimée. »
## 1. Education hors-pair
De fait s'ouvre une réflexion générale sur l'éducation morale des jeunes-filles.
Rôle-clé de la mère, moteur des questionnements et tourments à venir de la Princesse de Clèves : de même que la fille se différencie des autres par sa beauté, la mère le fait par son opinion sur l'éducation → opposition entre le pluriel généralisant « la plupart des mères » + présent de vérité générale, et le nom propre dans une phrase brève sans subordonnée ni complément, d'où l'impression d'assurance, de certitude péremptoire ;
De même au sujet des « galanteries », opposition de la négation « jamais » et de l'imparfait itératif (« faisait » renforcé par l'adverbe « souvent », « montrait », « contait » etc) soulignant le refus de la censure qui maintient les jeunes-filles dans un état d'ignorance au lieu de les instruire.
D'où l'implication forte de la mère soulignée par l'anaphore « elle lui » et l'asyndète (juxtaposition avec « ; ») : le passage résume les leçons assénées au fil des années, c'est donc un discours narrativisé, qui donne au lecteur l'impression d'être présent à son tour.
Cette éducation hors-norme se focalise sur la question de l'amour.
2. Antithèse manichéenne
Ce discours de vérité renforce l'opposition des genres masculin et féminin.
Soin de révéler l'ambivalence de l'amour, la part de séduction et de plaisir mais aussi celle de désordre et de souffrance → jeu d'antithèse avec « agréable » / « dangereux », renforcé par le parallélisme de construction « ce qu'il a d'... » // « ce qu'elle lui en apprenait de... » ;
Antithèse redoublée par l'opposition des genres : les hommes avec accumulation de défauts (rythme ternaire : 1 « peu de sincérité » 2 « tromperies »3 « infidélité ») mettant en péril le mariage (mention des « malheurs domestiques ») au centre de l'existence des femmes, et « l'honnête femme » caractérisé par des valeurs positives (« tranquillité », « vertu », « éclat », « élévation » ; opposition renforcée par la locution « d'un autre côté ».
D'où : un modèle idéal alliant en un redoublement de rythmes binaires les meilleurs qualités, avec la « beauté » et la « naissance » ; de même nuances hyperboliques dans l'emploi d'interrogatives indirectes avec « quelle » ou « combien ».
Cette vision de l'amour associe la femme à la vertu morale, menacée par l'immoralité masculine.
3. Prix de vertu
Or l'opposition entre vertu féminine et immoralité masculine se prolonge en une lutte psychologique interne.
Rupture avec la coordination « mais » → la « défiance » glisse des hommes vers soi, avec l'emploi de tournures réfléchies (pronom « soi-même » et verbe « s'attacher ») ; violence de cette lutte intérieure marquée par l'interrogative indirecte « combien » associée à la tournure impersonnelle (« il était difficile »), les qualificatifs « extrême » et « grand » et la tournure restrictive « que par... » pour en marquer le caractère décisif.
Tradition conservatrice liant étroitement condition féminine et mariage (chiasme sur la réciprocité de l'amour marital -pourtant paradoxal au vu de la description des hommes) : insistance avec « seul » et l'emploi généralisant de l'article indéfini « une femme » (=toutes les femmes) → l'esprit d'indépendance de la mère se limite à l'instruction morale sans interroger le statut de la femme.
Cet enseignement, étape par étape, débouche sur une intériorisation du devoir marital, où la fille est invitée à se méfier de son propre désir, plus encore que des hommes.
III. Intrigue
De « Cette héritière... » à la fin.
1. Stratégie matrimoniale
D'où un retour au présent centré sur l'enjeu du mariage de l'héroïne et les ambitions maternelles.
La seconde mention de l'héritage, de la fortune et du titre familiaux (avec la périphrase « cette héritière ») devient un atout matrimonial → superlatif « un des plus grands partis... » (=la meilleure possibilité de mariage) ; d'où des manœuvres exceptionnelles, précoces (adjectif « extrême ») et à distance (puisque Madame de Chartres s'est isolée en province) + insistance sur l'idée de pluriel avec le déterminant « plusieurs » et l'emploi du « on » indéterminé renvoyant à une masse de personnes indistinctes.
Autre facette de la mère –déjà indépendante puis conservatrice- avec le défaut d'orgueil (renforcé par l'adverbe « extrêmement ») → instrumentalisation de la fille pour affirmer sa valeur et sa puissance, d'où la décision de repartir à la cour avec la fille en COD (« la mener »), comme un objet qu'elle irait vendre au marché (cela dit en conformité avec les mœurs de l'époque).
La description de l'héroïne et le récit de son éducation renforce l'enjeu du mariage, annonçant le dilemme amoureux à venir...
2. L'éclat
Pour renforcer cette prédestination dramatique, le narrateur insiste sur l'irrésistible éclat de l'héroïne...
Stratégie narrative double : non seulement focalisation interne avec le vidame de Chartres pour en pointer la surprise mais redoublement du narrateur (« avec raison ») lui-même subjugué au point d'intervenir dans le récit par la beauté de l'héroïne.
Une beauté qui ne se laisse que peu décrire mais se pressent dans l'hyperbole : adjectif « grande » + caractère exceptionnel avec la double négation (« jamais » + restriction « qu'à elle ») + idée de surabondance (déterminant « tous ses... » + polyptote = multiplication des conjonctions de coordination « et son visage et sa personne » + idée de complétude avec « pleins de » et son rythme binaire associant 2 qualités « grâce » et « charmes »).
Seul indice concret : la blancheur, avec pâleur du teint et blondeur des cheveux → signe d'innocence (//jeunesse des 16 ans) ; l'absence de vice, sa pureté, participe de la beauté de l'héroïne.
Or c'est précisément cette innocence qui sera mise à l'épreuve dans le récit à suivre.
La Princesse de Clèves saura-t-elle rester belle jusqu'à la fin du roman ?...

Tu n'as pas le compte Premium !
Si tu souhaites mettre à jour ton compte, pas de problème !
Clique ici, et mets à jour ton compte (onglet : mon abonnement).
